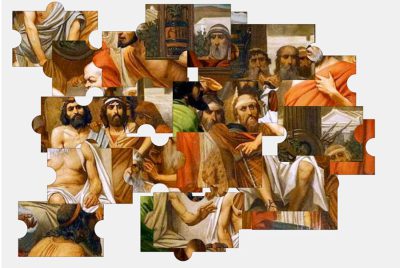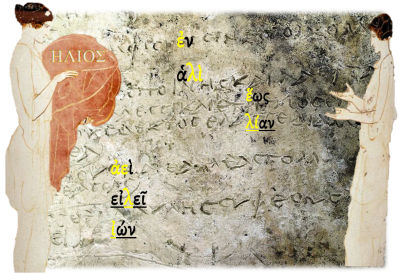Ce séminaire portera sur deux types apparemment très différents de réalisations techniques, associant, pour les mettre en regard, techniques humaines et techniques animales : les constructions humaines destinées à l’occupation animale (bergerie, parc, niche, volière, etc.), et, d’autre part, les aménagements de lieux de résidence et les constructions d’espace d’habitation réalisées par l’animal pour lui‐même (nid, termitière, ruche, toile…). La notion d’habitat est entendue dans un sens assez limité et différente de celle d’“aire“, impliquant donc un certain degré de sédentarité. Les questions pourront porter, entre autres, sur les types de structures matérielles, l’évolution et l’adaptation environnementale ou biologique des techniques, la connaissance éthologique des aptitudes et des comportements de construction des animaux « architectes», la relation entre habitats « spontanés » et habitats « programmés » pour les animaux sauvages intégrés à l’espace humain, les fonctions explicites ou implicites dévolues à la construction (enfermer, protéger, acclimater, conditionner, favoriser la reproduction…). Les approches disciplinaires pourront être diverses, dans une période allant de la préhistoire à l’époque moderne, et les types d’habitat courants ou exceptionnels (zoo, caisse de voyage, animalerie de laboratoire, aquarium…).
Rencontres scientifiques à venir
Consulter toutes les rencontresConference | Peripatetic Ethics in Theophrastus and After
Project Theophrastus
Appel à communication et à posters | Les datations « absolues » en archéologie
8e séminaire scientifique et technique de l’Inrap
Call for Papers | Ancient and Medieval Greek Etymology as heuristic and pedagogic tool. The case of common words
4th Etygram Conference, April 28-29-30, 2025
44e Rencontres Internationales d’Archéologie et d’Histoire | Fumier, bouses et guano : ordures ou or brun ?
Statut, usage et gestion des déjections animales depuis la Préhistoire ; potentiel archéologique et paléoenvironnemental – 44èmes Rencontres Internationales d’Archéologie et d’Histoire de Nice Côte d’Azur.
Conférence publique | Une Approche Anthropologique du fumier. Un artefact pas comme les autres
à 20h par Sophie LALIGANT, Anthropologue. Professeure des Universités, Université de Tours dans le cadre des 44e RENCONTRES INTERNATIONALES D’ARCHÉOLOGIE ET D’HISTOIRE DE NICE CÔTE D'AZUR
Colloque Zoomathia | « Il ne leur manque que la parole » : Sons, cris et voix des animaux dans les cultures antiques et médiévales
Colloque international du réseau international de recherche ZOOMATHIA