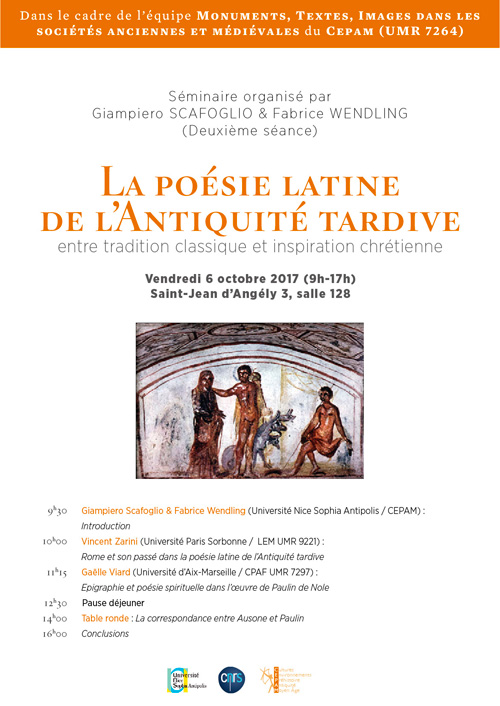
Typologie d'événements : Colloques & Séminaires
Lectura Dantis Nicaeana
Venerdì 1 dicembre – 17h00 à 19h30 – Teatro Garibaldi
Consolato Generale d’Italia
72, boulevard Gambetta, Nizza
17.00 – Introduzione
Sabino Lafasciano (Dirigente Ufficio didattico-culturale)
Giampiero Scafoglio (Université de Nice Sophia Antipolis / CEPAM)
Rosa Maria Dessì (Université de Nice Sophia Antipolis / CEPAM)
17.30 – Lettura del Canto I dell’Inferno
Raffaele Giglio (Università di Napoli Federico II)
18.30 – Comunicazioni scientifiche
La Commedia dal pulpito: un pellegrinaggio ‘virtuale’ nell’aldilà
Pietro Delcorno (University of Leeds)
Da Firenze a Roma. Appunti per una biografia di Dante politico
Giuliano Milani (Université Paris-Est Marne-la-Vallee)
36 Years of Landscape Dynamics at Acconia in Southern Italy
Cette conférence est donnée dans le cadre des séminaires transversaux du CEPAM (Du site au territoire, interactions sociétés milieux) et du projet CIMO (Céramiques imprimées de Méditerranée occidentale, ANR-14‐CE31‐009).
Cette présentation sera dédiée aux recherches de terrain conduites à Acconia (Calabre, Italie) http://acconia.colgate.edu/. Il s’agit d’une étude longitudinale du paysage tout-à-fait exceptionnelle fondée sur des prospections et sur la cartographie de l’ensemble du parcellaire, réalisées tous les 9 ans, entre 1980 et 2016. Parmi les nombreux développements de cette étude dans les domaines anthropologique et archéologique, l’accent sera mis sur le village néolithique de Piana di Curinga (Culture de Stentinello, 6e millénaire avant N.E.), la fouille de ses unités d’habitation et son inscription dans le paysage.
Albert Ammerman s’est fait connaître dans les années 1970 pour son travail pionner conduit à Stanford avec Luca Cavalli Sforza sur les modèles de diffusion du Néolithique en Méditerranée, couplant données radiométriques et génétiques. Au-delà de la transition néolithique en Europe et les premières navigations méditerranéennes, son approche transdisciplinaire l’a conduit à traiter d’important sujets d’archéologie environnementale, qu’il s’agisse du Forum romain des origines et de l’approvisionnement de la ville antique en terres architecturales, ou encore des origines de Venise et de sa sauvegarde.
http://www.colgate.edu/facultysearch/FacultyDirectory/albert-ammerman
Contacts : claire.delhon@cepam.cnrs.fr / didier.binder@cepam.cnrs.fr
Les interactions entre la fabrique urbaine et le territoire proche et lointain à l’époque médiévale
9 h 30 — Philippe JANSEN (Université Côte d’Azur, UMR 7264 CEPAM) : « Introduction : que se passe-t-il autour de la ville ? »
10 h — Elisabeth LORANS (Université de Tours, UMR 7324 CITERES-LAT) : « Les villes et leur périphérie : la question des relations entre /civitates/ et /wics/ dans l’Angleterre du haut Moyen Âge. »
10 h 45 — Giovanni STRANIERI (Université de Saint-Etienne, UMR 5648 CIHAM) : « Espaces agraires et territoires urbains du VIIe au XVe siècle en Italie méridionale: le cas des cités de Tarente, Brindisi et Oria (Pouille). »
11 h 30 — Denis MENJOT (Université de Lyon 2, UMR 5648 CIHAM) : « Les interactions entre les villes de la couronne de Castille et leurs territoires »
12 h 15 : Pause déjeuner
14 h — Hadrien PENET (Paris) : « Le système des “ fiumare ” : organisation et mise en valeur du territoire péri-urbain de Messine (XIIe – XVe siècles) »
14 h 45 — Mathieu BEGHIN (Université de Picardie, EA 4284 TRAME) « Entre ruralité et urbanité : la construction des paysages faubouriens face aux exigences de la ville (Amiens, XIe-XVe siècles) »
15 h 30 — Germain BUTAUD (UCA, UMR 7264 CEPAM, équipe MTI) « Territoire urbain et castrum déchu en Comtat Venaissin : le cas de l’Isle-sur-la-Sorgue et de Menemènes d’après un procès des années 1360 »
16 h 15 :Conclusions
Les nefanda stupra de Catilina (Sall. Catil.15) • Graziana Brescia
Jeudi 14 septembre, 16h15-17h30 – Campus Carlone, 98 bd Edouard Herriot, salle H319
Cycle de Séminaires Master Recherche Lettre Classiques / Agrégation organisé par Giampiero Scafoglio – Première séance (séminaire ouvert au public)
Graziana Brescia, Professeur de Langue et littérature latines (Université de Foggia)
Préhistoire dans la moyenne vallée du Jabron (Var): actualités et bilan de la recherche
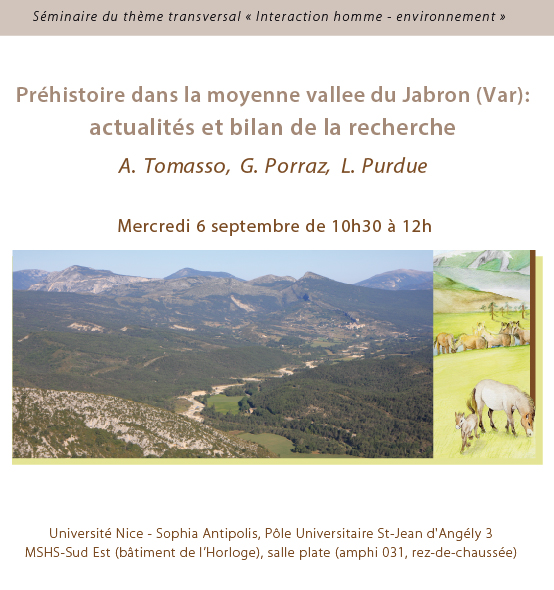
Qui est là? Représentativité et sélectivité en contextes funéraires.
Dans le cadre des activités du réseau le Posgrado en Antropologia Fisica (PAF) de l’Escuela Nacional de Antropologia e Historia (ENAH) avec le Culture et Environnements Préhistoire, Antiquité Moyen Âge (CEPAM) de l’Université Côte d ́Azur et Le Centre National de la recherche scientifique organisons une journée d’étude sur la Représentativité et sélectivité dans les échantillons archéologiques.
program.pdf
Journée d’étude proposée par :
Geraldine Granados et Isabelle Séguy
Mardi 27 Juin 2017
16h à 19h30 France/ 9h-12h30 Mexique
Délégation régionale du CNRS, Sophia Antipolis
http://www.cote-azur.cnrs.fr/PlanAcces/;view
250 rue Albert Einstein, Bâtiment 3-salle Mimosa 06 905 SOPHIA ANTIPOLIS
The Physiologus between East and West
Thursday 15.6.2017
14:00-14:30 Welcome address and introduction to the conference
Session 1 – The Greek Physiologus: Manuscripts and contexts (chair: S. Lazaris)
14:30-15:15 Horst Schneider, “Der Physiologus: Grundlagen und Perspektiven”
15:15-16:00 Arnaud Zucker, “The evolution of the Greek Physiologus in the three recensions”
Coffee break
16:30-17:15 Adele Di Lorenzo, “La tradition du Physiologus grec dans les manuscrits de la BNF et de la BAV. Réflexions pour une étude comparée”
17:15-18:00 Alain Touwaide, “The Physiologus and the tradition of the iatrosophia”
Reception
Friday 16.6.2017
Session 2 – The illustrations of the Physiologus in a comparative perspective (chair: A. Dorofeeva)
9:00-9:45 Massimo Bernabo, “Testi classici come fonte delle miniature del Fisiologo di Smirne”
9:45-10:30 Jacqueline Leclercq-Marx, “Un champ métaphorique exemplaire. À propos du rapport entre texte et illustration dans le Bruxellensis 10066-77 (Meuse ?, fin du Xe s.)”
10:30-11:15 Stavros Lazaris, “L’illustration du Physiologus d’après certains manuscrits grecs de la Renaissance”
Coffee break
Session 3 – Eastern traditions 1 (chair: C. Macé)
11:45-12:30 Gohar Muradyan & Aram Topchyan, “The Armenian Physiologus”
12:30-13:15 Jost Gippert, “The Georgian Physiologus”
Lunch break
Session 4 – Eastern traditions 2 (chair: J. Gippert)
14:30-15:15 Alin Suciu, “The Coptic Physiologus: Evidence of an Early Translation”
15:15-16:00 Massimo Villa, “The Ethiopic Physiologus: Manuscript tradition and Desiderata”
16:00-16:45 Sami Aydin, “The Syriac Physiologus Versions and Related Bestiaries”
Coffee break
Session 5 – Eastern traditions 3 (chair: V. Pakis)
17:15-18:00 Sybille Wentker, “The Arabic Physiologus, early text in late transmission?”
18:00-18:45 Anissava Miltenova, “The Physiologus in Balkan Cyrillic Manuscripts: from Textological to Socio-Rhetorical Approach”
18:45-19:30 Ana Stoykova, “The Slavic translation of the Pseudo-Basilian recension: the compilation approach”
Saturday 17.6.2017
Session 6 – Editions and future prospects (chair: A. Zucker)
9:00-9:45 Anna Dorofeeva, “The early mediaeval Latin Physiologus between tradition and innovation”
9:45-10:30 Emmanuelle Kuhry, “Le projet Physiologus – Stemmatologie. Résultats et perspectives pour une édition électronique”
Coffee break
11:00-11:45 Caroline Macé, “Why new critical editions of the Physiologus in various languages (in Greek and Latin especially) are still needed”
Session 7 – Round Table
11:45-13:00 Round-Table on publication and editorial projects, led by Valentine A. Pakis
Organizers:
- Anna Dorofeeva (Goethe-Universität Frankfurt)
- Stavros Lazaris (CNRS, UMR Orient & Méditerranée/ Labex RESMED)
- Caroline Macé (Goethe-Universität Frankfurt / Akademie der Wissenschaften zu Göttingen)
- Arnaud Zucker (Université Côte d’Azur)
Les insécurités dans le bassin du lac Tchad
Programme
Depuis la crise du Darfour, l’insurrection de Boko Haram et l’embrasement de la Centrafrique, le bassin du lac Tchad focalise l’attention des médias et des pouvoirs publics. Les insécurités, le thème choisi pour le XVIIe colloque du réseau Méga-Tchad, apparaît, plus que jamais, d’une actualité que l’on ne peut éluder. Au-delà d’alimenter les bruits de gazette, les insécurités sont un élément structurant des organisations sociales, facteurs de blocages et moteurs de changements des hommes, de leurs cultures, de leurs organisations et de leurs productions. Les tragiques événements que traverse la région du lac Tchad rappellent la capacité destructrice des violences, mais ne doivent pas faire oublier les adaptations, les résiliences, voire les innovations déployées pour y faire face, les contourner et les dépasser.
Dans un espace géographique marqué par des insécurités chroniques, mais dans lequel les armes et les arts de la guerre, les encadrements spatiaux et politiques, les vecteurs de communication et les modes de résolution des conflits ont changé, les violences armées actuelles comportent une profondeur historique. L’histoire du bassin du lac Tchad semble marquée du sceau de la grande violence, tant l’usage intense de la force est transversal à toutes les périodes historiques, des esclavages et des royaumes précoloniaux aux Etats indépendants et aux rébellions, en passant par les colonisations et les guerres mondiales. Dans les périodes de relative accalmie, les insécurités endémiques n’ont jamais cessé d’être, entretenues par les embuscades rurales de bandes de pillards (« voleurs de bétail », « coupeurs de route »), la criminalité urbaine et des autoritarismes politiques se servant des corps habillés, à la fois garants de la stabilité et facteurs d’instabilité.
Les insécurités transforment les organisations sociales en s’insérant dans leur quotidienneté. Face à la prolifération de la violence les groupes sociaux adaptent leurs manières de gouverner et de produire, d’habiter et de circuler, d’échanger et de communiquer. Au-delà des faits d’armes, les insécurités, comme inquiétudes provoquées par l’éventualité d’un danger, renvoient à l’ensemble des risques auxquels sont confrontées les personnes dans leur vie ordinaire, notamment les imprévisibilités productives, les incertitudes foncières, les conflits locaux et les violences de proximité (famille, école, genre, justice, etc.). Doivent être approfondis les liens entre ces insécurités mêlant des vulnérabilités et des aléas divers dans leur intensité, leurs échelles et leurs temporalités.
Les encadrements sociaux se recomposent dans les insécurités. La compréhension du fonctionnement des Etats demeure centrale dans les conflits armés, le plus souvent internes et qui tendent à se régionaliser, interrogeant les limites intérieures et les politiques extérieures des organisations politiques centralisées. L’importance des rhétoriques et des actions extrémistes placent la religion comme le second grand enjeu des insécurités actuelles et passées. La lutte pour le contrôle des ressources par des réseaux, des bandes, des leaders ethno-régionaux et des autorités centrales informent et transforment aussi les encadrements sociaux. La fabrique des institutions internationales et des arènes politiques locales constituent d’autres niveaux d’interprétation des insécurités.
Attention : pour y assister votre inscription est obligatoire via cette adresse : olivier.langlois@cepam.cnrs.fr
Insecurities in the Lake Chad basin
Ever since the crisis in Darfur, the Boko Haram insurrection and the conflagration in the Central African Republic, the Lake Chad basin has been a focus of media and government attention. Insecurities, the theme chosen for this 17th Mega-Chad colloquium, has become a topic that can no longer be avoided. Beyond media attention, insecurities play a major part in structuring social organizations. They either block or force change at the level of individuals, their cultures, their organizations and their productions. The tragic events that have played out in the region demonstrate the destructive potential of violence, and yet we should not forget that these events also stimulate adaptations, resilience and resistance that can lead to innovations and new ways of coping with such situations, and to new means of facing, circumventing or overcoming them.
In a geographic area characterized by chronic insecurity over the long term, weapons and the arts of war, political arenas, means of communication and ways of solving conflicts have changed over time. Outbreaks of insecurity in the present are deeply rooted in the past. The history of the Lake Chad basin is marked by tremendous violence, an intense use of force pervading all periods of history, from the early times of precolonial kingdoms and widespread slavery, through colonization and world wars, and on to later independent states and rebellions against them. Even in relatively quiet periods, endemic insecurity never ended but took various forms: ambushes in rural areas carried out by bands of pillagers (rustlers and highwaymen), urban crime, and the crimes of authoritarianism, mediated by uniformed “forces of order” that play a dual role as guarantors of stability and generators of political instability.
Insecurities transform social organizations by imposing themselves on everyday life. Faced with the proliferation of violence, social groups modify their forms of self-government and production, of dwelling and traveling, of exchange and communication. Beyond actual acts of violence, insecurities (in the form of anxieties provoked by the likelihood of danger) contribute to the sum of risks confronting people in their daily lives, and notably unpredictabilities in production, uncertainties regarding property, local conflicts and more proximate violence (within the family, at school, gender conflicts, law and order, etc.). Research is needed on the links between these insecurities that fuse vulnerabilities and hazards of different types and intensities, scales and durations.
Insecurities also lead to the reconstitution of political structures. Understanding of the functioning of states remains central to the study of armed conflicts, which tending to begin as internal conflicts often take on a regional dimension, challenging the internal workings and external politics of centralized political organizations. The significance of rhetorics and extremist actions make religion the second key factor in present and past insecurities. The struggle for the control of resources by networks, bands, regional or ethnic leaders, and central authorities also sheds light on social frameworks and their transformations. The fabric of international institutions and of local political arenas offers further possibilities for research on insecurities.
Approches genrées des populations du passé : Archéologie-Bio anthropologie-Histoire
Les études de genre en France sont un domaine de recherche relativement récent en histoire, plus encore en archéologie, et pas trop exploité en bioanthropologie. Elles visent à observer les hommes et les femmes du point de vue de leur place respective dans la société et des rapports qu’ils entretiennent entre eux, et non pas seulement par leurs différences biologiques, comme ce fut longtemps le cas.
Considérer le genre, et non le sexe, permet de mieux comprendre certaines fragilités biologiques et de les relier à des attributions sociales différentes et à un accès souvent hiérarchisé à la nourriture et aux soins.
Il nous a donc semblé intéressant de confronter les expériences des uns et des autres, en réunissant une douzaine de collègues, archéologues, anthropologues, paléopathologistes et historiens autour des questions de genre appliquées aux populations du passé.
Journée d’étude proposée par Luana Batista Goulart (Université Côte D’Azur/CEPAM) et Isabelle Séguy (INED/CEPAM)
Mercredi 7 juin 2017 – 10h à 18h30
Délégation régionale du CNRS, Sophia Antipolis
http://www.cote-azur.cnrs.fr/PlanAcces/;view
250 rue Albert Einstein – Bâtiment 3 – salle Mimosa
06 905 SOPHIA ANTIPOLIS

